Qu’un intellectuel ouvertement athée comme Juan José Millás écrive dans El País une chronique reconnaissant, même avec ironie, la magnitude ontologique du miracle eucharistique devrait provoquer plus qu’un sourire gêné dans le monde catholique. Cela devrait nous obliger à nous arrêter et à nous demander ce qui ne va pas quand même un observateur externe détecte une dissonance profonde entre ce que l’Église affirme croire et la manière dont ce mystère est vécu — ou trivialisé — dans la pratique.
Millás n’écrit pas en tant que croyant ni ne prétend l’être. C’est précisément pour cela que son diagnostic est si révélateur. Il part d’une prémisse doctrinale correcte : l’Église enseigne qu’à la consécration se produit un changement réel, littéral, substantiel. Pas symbolique. Pas métaphorique. Un miracle de premier ordre. Et pourtant, il constate quelque chose que n’importe qui peut vérifier : la scène habituelle de nombreuses célébrations liturgiques ne reflète en rien la transcendance de ce qui s’y passe. Gestes fatigués, distraction généralisée, routine. Comme si rien d’extraordinaire ne se produisait.
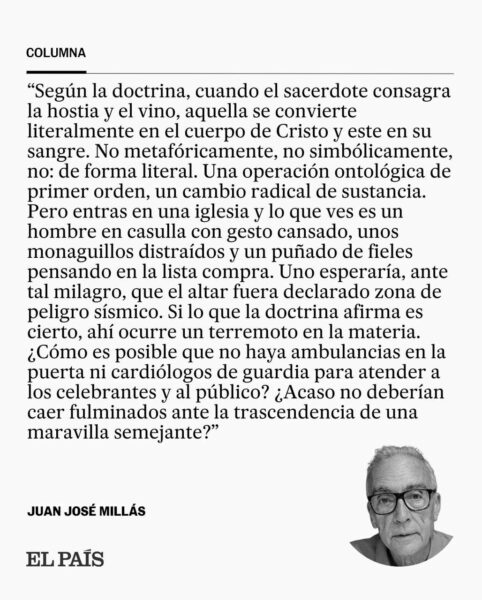
La question qu’il pose — avec sarcasme, mais avec logique — est dévastatrice : si nous croyons vraiment ce que nous disons croire, pourquoi n’agissons-nous pas en conséquence ? Pourquoi n’y a-t-il pas de tremblement, d’émerveillement, de crainte révérencielle ? Pourquoi l’autel ne semble-t-il pas une zone sacrée, séparée, gardée ?
C’est ici que l’observation externe se transforme en accusation interne. Ce n’est pas l’athée qui banalise le mystère. C’est nous. Ou du moins, une façon de vivre la liturgie qui a progressivement érodé le sens du sacré jusqu’à le rendre presque invisible.
Il ne s’agit pas d’exiger du théâtre ni de l’hystérie religieuse. Il s’agit de cohérence. L’Église a toujours su que le mystère exige une garde. Pendant des siècles, tant en Orient qu’en Occident, des formes concrètes de protéger le sacré se sont développées : séparation du presbytère, gestes précis, silence, voiles, signes de distance. Non par mépris pour le peuple, mais par conscience du mystère.
En Occident, cette conscience s’est affaiblie. Et ce qui s’est perdu n’était pas la proximité, mais l’émerveillement. Pas la participation, mais la révérence. Quand tout est montré, tout est banalisé. Quand rien n’est protégé, rien n’est vénéré.
C’est pourquoi il est significatif — et préoccupant — qu’un non-croyant soit celui qui pointe l’incohérence, car il perçoit une fissure évidente : une Église qui proclame le plus grand des miracles et le célèbre comme s’il s’agissait d’une formalité.
Le problème n’est pas que le monde ne croie pas en l’Eucharistie. Le problème est que souvent, il ne semble pas que l’Église elle-même croie vraiment en ce qu’elle garde. Et quand le mystère cesse de structurer la liturgie, il finit par diluer aussi la foi.
Peut-être est-ce l’une de ces occasions où il convient d’écouter même celui qui parle de l’extérieur. Pour reconnaître que la fissure est si visible qu’elle ne passe plus inaperçue. Quand même les athées perçoivent la contradiction, c’est le signe que quelque chose d’essentiel a besoin d’être corrigé.
La question finale n’est pas rhétorique : voulons-nous continuer à expliquer le mystère ou revenir nous agenouiller devant lui ? Parce que la foi ne se soutient pas seulement avec des mots corrects, mais avec des gestes qui les rendent crédibles.
