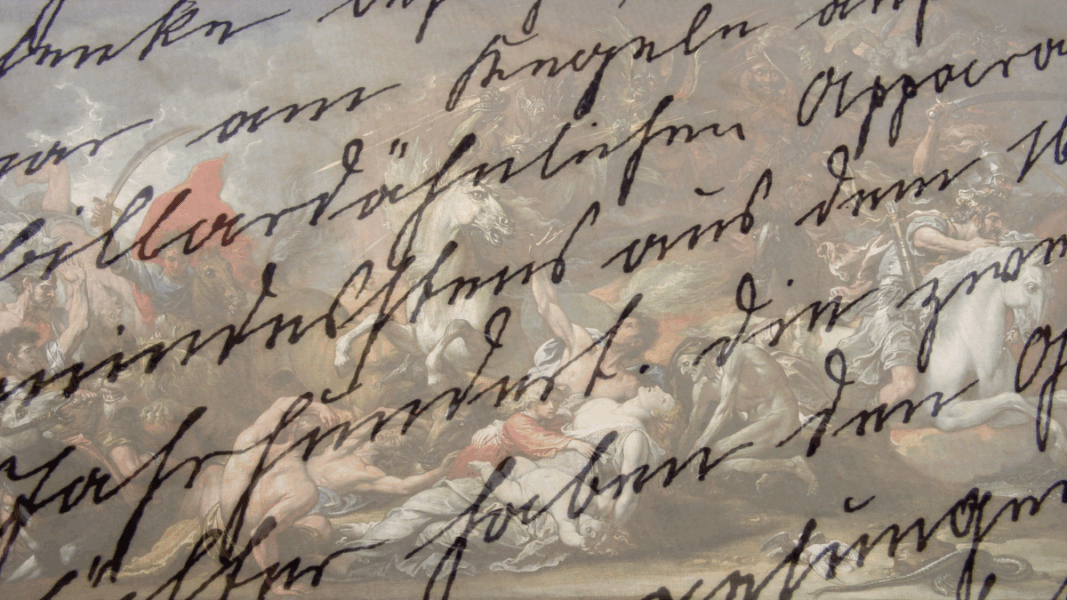«Mort sur le cheval pâle» de Benjamin West.
Sainteté, vous devrez excuser mon insistance importune, mais ma conscience m’urge à vous adresser à nouveau cette lettre ouverte à l’occasion de votre message lors de l’Angélus du dimanche 2 novembre dernier, dont j’ai extrait les paragraphes suivants, que je mets en italique, et que je commente ci-après.
C’est ainsi que se manifeste le centre de la préoccupation de Dieu : que personne ne se perde pour toujours, que chacun ait sa place et brille dans sa singularité.
Dieu peut être aussi préoccupé qu’il le souhaite à ce sujet ; mais la question est : peut-on, en fait, perdre quelqu’un pour toujours, c’est-à-dire : condamner éternellement ? ; si la réponse est oui, à quoi sert alors la préoccupation de Dieu ? ; l’omnipotent ne pourra-t-il pas faire ce qu’il désire le plus ? ; j’ai essayé de résoudre cette question dans la lettre que je vous ai déjà adressée par ce même moyen sur la question « de auxiliis » ; mais je l’ai remise sur le tapis en raison de l’intérêt invariable qu’elle suscite, et que se passe-t-il, si la réponse est non ? : les conséquences, je les aborde plus loin.
Comme l’écrivait Benoît XVI, l’expression « vie éternelle » veut donner un nom à cette attente inéluctable : non une succession sans fin, mais l’immersion dans l’océan de l’amour infini, où le temps, l’avant et l’après cessent d’exister. Une plénitude de vie et de joie : voilà ce que nous attendons et désirons de notre être avec le Christ (cf. Enc. Spe salvi, 12).
Je suis ravi, car tout n’est pas négatif, de lire ces paroles les vôtres, car elles me conviendraient parfaitement pour une digression sur une théorie que, plusieurs années auparavant, j’ai envoyée à la Congrégation pour la doctrine de la foi, et dont je suis encore en train d’attendre la réponse, cela dit : bien assis, car il ne s’agit pas de se faire une hernie, une fois que j’ai déjà épuisé mes méninges, et je ne sais pas si pour quelque chose d’utile ; mais, comme, suivant la recommandation de Jack l’Éventreur, il vaut mieux y aller par parties, je laisse ce sujet, si l’occasion se présente, pour une autre lettre ouverte, à moins que la météorite ne l’empêche.
La préoccupation de Dieu de ne perdre personne, nous la connaissons de l’intérieur, chaque fois que la mort semble nous faire perdre pour toujours une voix, un visage, un monde entier. Chaque personne est, en effet, un monde entier. La journée d’aujourd’hui défie la mémoire humaine, si précieuse et si fragile. Sans la mémoire de Jésus — de sa vie, de sa mort et de sa résurrection —, l’immense trésor de chaque vie reste exposé à l’oubli. Dans la mémoire vivante de Jésus, en revanche, même celui que personne ne se souvient, même celui que l’histoire semble avoir effacé, apparaît dans sa dignité infinie.
Comment la mort pourrait-elle nous faire perdre quelqu’un pour toujours, si nous non plus nous ne serons pas là pour toujours ? ; la seule chose qui nous fait vraiment perdre quelqu’un pour toujours, c’est la condamnation, qu’elle soit la nôtre ou la sienne.
Réduire tout à la mémoire sonne aussi creux que cette phrase rebattue et lapidaire, le mot est faible, : « Il vivra pour toujours dans notre cœur » ; peut-on appeler « vie » l’image éphémère qui reste en mémoire, et que le temps impitoyable s’occupe de défigurer implacablement ? ; qu’est-ce alors sinon pure vanité la gloire qui reste en mémoire ? ; c’est pourquoi on disait autrefois que mieux vaut un chien vivant qu’un lion mort, et le nom est une simple coïncidence, que Dieu vous accorde de longues années.
J’espère que la dignité infinie à laquelle vous vous référez n’est pas simplement naturelle, comme celle qui apparaît dans le document Dignitas infinita, qui y reste d’ailleurs, imperturbable dans le catalogue du magistère de l’Église, où il colle comme un saint Christ deux pistolets.
Telle est l’annonce pascale. C’est pourquoi les chrétiens se souviennent depuis toujours des défunts dans chaque Eucharistie, et jusqu’à aujourd’hui demandent que leurs êtres chers soient mentionnés dans la prière eucharistique. De cette annonce naît l’espérance que personne ne se perdra.
Si Dz 825 anathématise la thèse selon laquelle « le justifié est obligé de croire de foi qu’il est au nombre des prédestinés », et, par conséquent, personne ne peut avoir de certitude de foi sur sa propre salvation, ce qui exclut aussi la certitude de la persévérance finale, laquelle apparaît condamnée, sauf révélation spéciale, dans Dz 826, comment ne pas considérer comme hérétique l’affirmation qu’on peut espérer que personne ne se perdra, quand il est évident que l’espérance que personne ne se perdra suppose la certitude de foi que tous et chacun, en persévérant jusqu’à la fin, nous serons sauvés ?
De plus, saint Paul dit, d’une part, que « la foi n’est pas de tous » (2 Ts 3, 2), et, d’autre part, que « sans la foi il est impossible de plaire à Dieu » (Hé 11, 6) ; alors comment peut-on dire, sans contredire l’apôtre, que tous, y compris ceux qui n’ont pas la foi, ni par là plaire à Dieu, vont se sauver ? ; comment aussi peut-on dire, contredisant Jésus, qui a clairement affirmé que tous n’ont pas cessé de se perdre, parmi lesquels il a nommé expressément le « fils de perdition » (Jn 17, 12), que personne ne se perdra ?
Enfin, si nous devons espérer que personne ne se perdra, mais que tous nous serons sauvés, ce qui, en nous affermissant dans la certitude du salut, empêche toute crainte réelle de condamnation, comment pourra-t-on éviter la condamnation que Dz 1525 lance contre ceux qui nient que « la crainte de l’enfer soit en soi bonne et utile comme don surnaturel et mouvement inspiré par Dieu » ?
La gravité de ce point est telle qu’elle dépasse même la position, déjà en soi hérétique, du protestantisme, qui défend la certitude du salut, mais non pour tous, comme, en revanche, il est indiqué là, mais seulement pour les croyants, ce qui suppose déjà une restriction ; la seule chose comparable est l’apocatastase, qui, au moins aussi, reconnaît une condamnation temporaire, et pourtant elle est, à son tour, fermement condamnée par Dz 211.
Dz 705 dit, en se référant aux hérétiques : « À tous ceux qui sentent diversement et contrairement, il les condamne, les réprouve et anathématise, et proclame qu’ils sont étrangers au corps du Christ, qui est l’Église » ; mais, bien sûr, qui aura l’audace de dire que celui qui apparaît précisément comme tête n’est même pas membre ? ; grande est donc mon angoisse, bien que je ne puisse m’y soustraire pour autant, car c’est ce que je lis dans Dz 271 et 274 : « Si quelqu’un (…) ne rejette et n’anathématise pas, d’âme et de bouche, tous les hérétiques néfandissimes avec tous leurs écrits impies jusqu’au dernier iota, (…) que cet homme soit condamné pour les siècles des siècles, et que tout le peuple dise : Amen, amen » ; il ne manquerait plus que tous se sauvent, sauf l’âne que je suis ; le peu insignifiant de ce prêtre qui a déjà été écarté de l’exercice du ministère public pourra-t-il alors réprimander celui qui occuperait la chaire suprême ? ; mais n’est-ce pas exactement cela que Dz 1105 indique, qui condamne cette phrase : « Même si tu sais évidemment que Pierre est hérétique, tu n’es pas obligé de le dénoncer » ? ; je n’ai, en définitive, d’autre remède en conscience, car moi je crains l’enfer, et je ne crois pas avoir la salvation garantie, que, en me jouant de tout, de dire ses quatre vérités jusqu’au lucero del alba, même s’il est reconnu comme « Pierre », et aussi inférieur que je me sente en comparaison, car déjà le Docteur Angélique disait que, « dans le cas où menacerait un danger pour la foi, les supérieurs devraient être repris même publiquement par leurs subordonnés, comme saint Paul, étant subordonné de saint Pierre, l’a repris en public » (Somme théologique II-II, q. 33, a. 4, ad 2).
Note : La lettre ouverte suivante exprime l’opinion personnelle de son auteur. Nous publions le texte pour son intérêt théologique et testimonial, exhortant le lecteur à le recevoir avec discernement et fidélité à la doctrine et au Magistère de l’Église.